Sur fond d’urgence climatique, une nouvelle étude menée entre Hawaï et l’Alaska révèle un constat bouleversant : les baleines à bosse mères dépensent une énergie colossale pour assurer la survie de leurs petits… au prix de leur propre santé. Grâce à des drones et une collaboration scientifique sans précédent, les chercheurs ont suivi la transformation physique de ces géantes au fil de leur migration.
Ce que révèle ce suivi est inquiétant : les femelles allaitantes perdent jusqu’à 20 % de leur masse en deux mois seulement, dans un océan où la nourriture se fait de plus en plus rare. Source : Université d’Hawaï (via ScienceDaily, déc. 2024).
Une migration qui coûte la vie à certaines mères
Une perte de poids drastique en quelques semaines
Grâce à une technologie de photogrammétrie par drone, les chercheurs ont suivi 1 659 baleines à bosse à différents stades de leur migration. Les femelles allaitantes ont été mesurées à plusieurs reprises : plus de 400 observations ont été effectuées sur 137 individus. Résultat ? Une perte moyenne de 17 % du volume corporel en six mois, principalement durant la période d’allaitement.
À Hawaï, les scientifiques ont même observé une perte de 214 livres de graisse par jour chez les mères, soit l’équivalent de 25 tonnes de harengs du Pacifique ou 50 tonnes de krill sur une période de deux mois. C’est plus que ce qu’elles dépensent pour une grossesse complète sur un an !
Les petits grandissent vite… au prix de leurs mères
Le contraste est saisissant : pendant que la mère s’amaigrit dangereusement, le baleineau, lui, voit son volume corporel augmenter de 395 % et sa longueur croître de 60 %. Autrement dit, l’énergie vitale de la mère est entièrement mobilisée pour donner un maximum de chances à son petit.
Cette stratégie maternelle, aussi magnifique que tragique, montre à quel point la reproduction chez les baleines à bosse est une période de grande vulnérabilité énergétique.
🧠 À retenir
Les mères baleines sacrifient une partie de leur corps pour assurer la croissance rapide de leur petit. En 60 jours, elles perdent jusqu’à 20 % de leur masse corporelle, dans un océan de plus en plus pauvre en proies.
Hawaï et l’Alaska : deux étapes vitales, deux mondes différents
À Hawaï, un sanctuaire menacé
Hawaï joue un rôle crucial comme zone de reproduction des baleines à bosse du Pacifique Nord. Mais entre 2013 et 2018, les rencontres mères-baleineaux ont chuté de 76,5 %. Pire : les naissances ont chuté de 80 % entre 2015 et 2016. Ces chiffres sont alarmants, d’autant plus qu’ils coïncident avec une canicule marine qui a bouleversé la chaîne alimentaire.
Cette surchauffe des eaux a considérablement diminué la disponibilité des proies, forçant les baleines à puiser dans leurs réserves… jusqu’à l’épuisement.
En Alaska, une reprise plus lente pour les mères
À l’inverse, en Alaska — où les baleines vont se nourrir — les femelles non allaitantes reprennent rapidement du poids : jusqu’à six fois plus vite que les mères encore en lactation. Ces dernières ne récupèrent que 15 kilos par jour, contre 90 pour les femelles gestantes. Le déséquilibre est tel que certaines mères n’arrivent plus à reconstituer leurs réserves, mettant en péril leur propre survie et celle de leur prochain cycle de reproduction.
Un suivi inédit sur des milliers de kilomètres
L’une des forces de l’étude réside dans sa capacité à suivre les mêmes individus sur plus de 3 000 kilomètres, entre Hawaï et l’Alaska. Huit paires mère-petit ont été mesurées dans les deux régions la même année — une prouesse scientifique et logistique qui permet d’évaluer l’évolution de leur condition physique sur la durée.
Un avenir incertain pour l’espèce si rien ne change
Une base de données sans précédent
Cette étude alimente désormais une immense base de données sur la santé des baleines à bosse dans le Pacifique Nord : 11 000 mesures sur 8 500 individus. Ce socle scientifique permettra d’évaluer la résilience de ces géants face aux menaces qui s’accumulent : changements climatiques, pénurie de nourriture, collisions avec les navires, filets de pêche…
Combinée à d’autres données biologiques (hormones de stress, comportements, autopsies), cette base pourrait devenir un outil de référence mondial pour anticiper le sort des cétacés.
Une collaboration exemplaire à préserver
Ce projet est né d’une alliance entre les équipes hawaïennes, la Pacific Whale Foundation et la Alaska Whale Foundation, démontrant que seule une approche collaborative et interdisciplinaire peut permettre de suivre des individus sur plusieurs mois, dans un milieu aussi vaste et mobile que l’océan.
Comme le souligne Jens Currie, chercheur et coauteur : « C’est en croisant les expertises que l’on peut comprendre comment les facteurs environnementaux impactent la santé maternelle et la croissance des petits ».
Cette étude-pivot rappelle une vérité essentielle : protéger les baleines à bosse, c’est préserver bien plus qu’un animal emblématique — c’est défendre un pilier de l’écosystème marin, mais aussi une culture et un équilibre fragiles, en particulier pour les communautés de l’océan Pacifique.
👉 Source originale : www.sciencedaily.com/releases/2024/12/241217201533.htm
✍️ Cet article a été rédigé par Marine L. (Journaliste marine & amoureuse des océans)
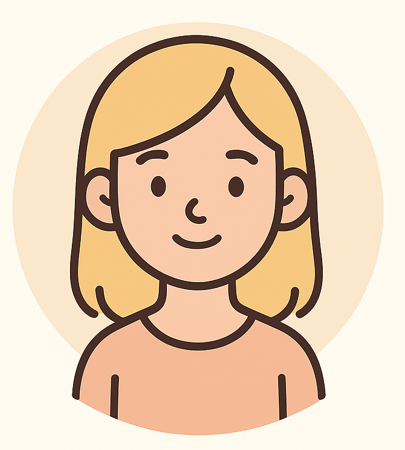
Marine documente la vie des orques depuis 12 ans entre Norvège et Canada. Fidèle à son prénom, elle connaît par cœur les saisons de hareng, les codes vocaux des différents pods, et les questions qu’on lui pose toujours






