Depuis plusieurs années, des baleines sont retrouvées mortes ou gravement blessées sur les côtes américaines. Collisions avec des navires, enchevêtrements dans des filets de pêche… les coupables semblent évidents. Mais une étude récente révèle un facteur invisible, et pourtant peut-être déterminant : certaines algues toxiques produiraient des effets neurologiques sur les cétacés, les rendant incapables d’éviter ces dangers.
Et ce phénomène inquiétant pourrait bien s’intensifier avec le réchauffement des océans. Voici pourquoi cela nous concerne tous, même depuis la France, le Québec ou la Belgique.
Les efflorescences d’algues toxiques : un danger sous-estimé
Des algues qui ne tuent pas toujours… mais désorientent
Certaines espèces d’algues, lorsqu’elles prolifèrent de façon excessive, produisent des neurotoxines puissantes. Ces efflorescences algales nuisibles (ou HABs, en anglais) ne provoquent pas nécessairement la mort immédiate des baleines.
Mais l’étude publiée dans Frontiers in Marine Science montre qu’elles pourraient les désorienter durablement, altérant leur perception, leurs réflexes et leur capacité à éviter des dangers comme les bateaux ou les filets.
Quand les algues et les baleines se croisent, les collisions explosent
Les chercheurs Greg et Katy Silber ont croisé les données sur les efflorescences algales et celles des mortalités de grandes baleines (comme les rorquals et les baleines à bosse) entre 2000 et 2021 sur les côtes est et ouest des États-Unis.
Le constat est troublant : les années où les blooms d’algues sont les plus marqués, les blessures et décès liés à l’activité humaine explosent. Sur la côte Pacifique, on observe jusqu’à trois fois plus de cas dans les zones touchées par les HABs.
🧠 À retenir
Les algues toxiques ne tuent pas toujours directement, mais elles pourraient altérer la vigilance des cétacés, les rendant vulnérables aux filets et aux navires. C’est une menace invisible mais bien réelle, aggravée par le changement climatique.
Comment ces toxines agissent sur les baleines
Deux types d’algues très toxiques pour les cétacés
Les principales espèces identifiées sont :
- Alexandrium : produit des saxitoxines, connues pour perturber le fonctionnement nerveux.
- Pseudo-nitzschia : produit de l’acide domoïque, une toxine pouvant provoquer des troubles moteurs, des comportements anormaux, voire des convulsions.
Ces toxines s’accumulent dans la chaîne alimentaire (krill, poissons) avant de finir dans le corps des baleines.
Des effets souvent invisibles… mais ravageurs
Même à faibles doses, ces toxines peuvent engourdir les sens, ralentir les réactions, et rendre les baleines incapables de se libérer d’un filet ou d’éviter un cargo. Le plus inquiétant ? Ces effets passent inaperçus à l’œil nu, sauf autopsie poussée.
Des effets aggravés par le climat et l’activité humaine
Le réchauffement de l’océan favorise la croissance des algues toxiques. L’agriculture intensive, en relâchant des nutriments dans la mer, accentue le phénomène. Un cercle vicieux se dessine : plus les océans se réchauffent, plus les algues prolifèrent… et plus les cétacés sont exposés.
Des solutions existent mais peinent à se mettre en place
Des modèles prédictifs pour éviter les accidents
L’étude plaide pour un couplage entre :
- Les modèles de prévision des efflorescences algales
- Les données sur la présence des cétacés et les routes maritimes
Cela permettrait de limiter la pêche ou ralentir les navires dans certaines zones à risque. Une stratégie comparable à celle déjà appliquée dans certaines zones du Golfe du Saint-Laurent au Canada pour protéger les bélugas.
Des obstacles politiques et économiques
Malgré les alertes, les réglementations sont lentes à évoluer. En janvier 2025, les autorités américaines ont retiré un projet de limitation de vitesse des navires, pourtant crucial pour protéger les baleines noires de l’Atlantique Nord, une espèce en danger critique d’extinction.
Un enjeu mondial, pas seulement américain
Les menaces liées aux HABs concernent toutes les côtes du monde, y compris l’Europe. La Méditerranée, par exemple, a vu une augmentation des proliférations d’algues toxiques. Et les baleines, dauphins et marsouins y sont tout aussi vulnérables.
Pourquoi il faut s’en inquiéter dès maintenant
Des populations en hausse mais sous tension
Aux États-Unis, certaines espèces de baleines voient leurs effectifs croître. Mais cela signifie aussi qu’elles sont plus nombreuses à risquer de croiser des activités humaines. Une population plus dense, dans des eaux plus polluées, avec des routes maritimes plus chargées = une équation dangereuse.
Des causes de mortalité humaines en hausse constante
Entre 2000 et 2021, plus de 1 400 baleines ont été blessées ou tuées par des interactions humaines sur les deux côtes américaines. La moitié des cas impliquent des baleines à bosse. Et ce n’est qu’une estimation minimale, car beaucoup de carcasses ne sont jamais retrouvées.
Des scientifiques divisés, mais inquiets
Certains chercheurs, comme Elliott Hazen de la NOAA, soulignent que le lien entre algues et collisions n’est pas encore prouvé de manière absolue. Mais tous s’accordent à dire que le phénomène mérite davantage d’études et une prise en compte immédiate dans la gestion maritime.
Ce sujet vous intrigue ? Le reportage complet est disponible ici : https://news.mongabay.com/2025/02/study-suggests-algal-blooms-disorient-whales-putting-them-in-danger/
✍️ Cet article a été rédigé par Thomas M. ( passionné de cétacés)
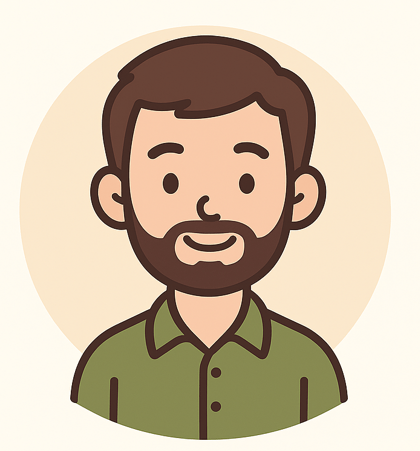
Thomas suit les orques depuis plus de 10 ans. Il connaît par cœur les différences entre un épaulard et un globicéphale, les migrations des pods du Pacifique Nord, et les questions qu’on lui pose toujours (« Mais… c’est vraiment des baleines ? »).






